France Culture, Les Chemins de la Conaissance, le 10 avril 1990
Un Amour de Loire
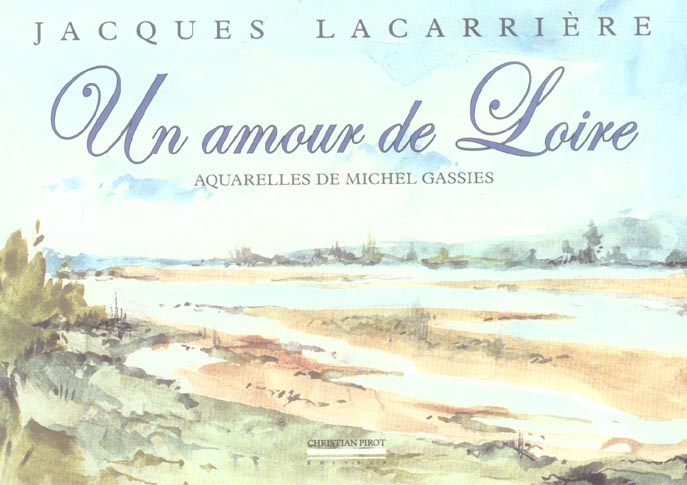
Un amour de Loire est un hymne au fleuve près duquel j’ai grandi et passé une grande partie de mon adolescence. Je pourrais le résumer par l’une des phrases qu’il contient : Je me demande ce que serait devenue ma vie sans la Loire. Très tôt, ce fleuve exalta mon imagination en me faisant rêver de mers et de pays lointains et en provoquant dans mon esprit mille réflexions sur la nature, le destin et la raison d’être des fleuves. Car je ne me suis pas contenté, alors, d’aimer et d’admirer la Loire, je l’ai parcourue, descendue, remontée à la nage et en bateau, sondée en ses moindres fonds et ses moindres recoins. Plus encore qu’un hymne, ce texte est un chant de complicité et de reconnaissance avec un fleuve unique et souverain, le dernier des fleuves encore en partie sauvages que peut compter l’Europe.
Jacques Lacarrière
Ce très beau carnet de Loire est illustré d’une quarantaine d’aquarelles et de miniatures, reproduites en couleur sur beau papier.
La Simarre, 2004
Ballade Argentique

Photographies de Pascal Gabard
17 et 18 septembre 2022
Vernissage le vendredi 16 septembre à partir de 18h30.
78, Grande Rue
SACY
89270 VERMENTON
Horaires: 10h30-12h30 & 14h-18h
La Grèce de l’Ombre
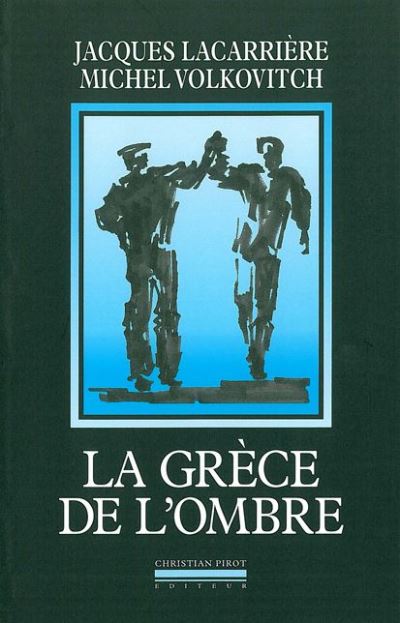
Anthologie des chants rébétika.
Traduction de Jacques Lacarrière et Michel Volkovitch,
Éditions Christian Pirot, 1999, Éditions Le Miel des anges 2014
Les Évangiles des Quenouilles
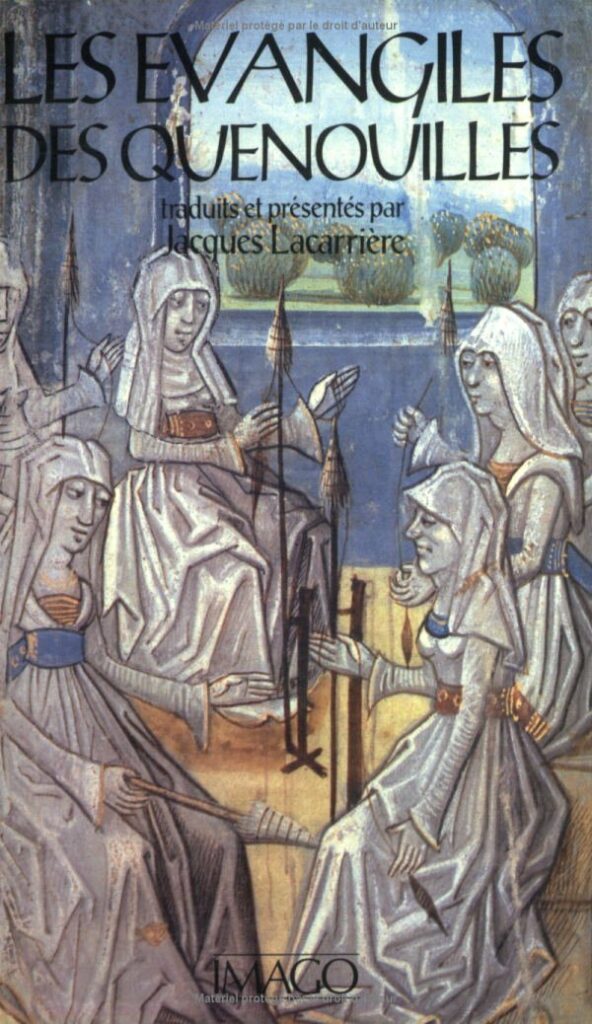
Traduits et présentés par Jacques Lacarrière
Écrit en « françois » mêlé de formes picardes et publiés à Bruges en 1480, Les « Evangiles des quenouilles » ont acquis très vite une grande popularité. Depuis longtemps, ce texte sert de référence à tous les spécialistes du folkore et de l’histoire des mentalités et pourtant, il n’avait jamais été traduit en français moderne jusqu’à ce jour.
Six femmes « sages doctoresses et inventeresses » se réunissent au cours de six veillées pour disserter à tour de rôle sur les maladies, remèdes, recettes, dictons, conseils et interdits de leur vie quotidienne. L’œuvre anonyme recueille donc un grand nombre de croyances et de superstitions concernant les femmes. Croyances qui ne sont nulllement mortes avec le Moyen Age et dont beaucoup survivent encore dans nos campagnes.
Éditions Imago 1987, Albin Michel, collection « Espaces libres », 1999
À la tombée du bleu

Illustrations de Giorgio de Chirico
Paris, Fata Morgana, 1986
Gens du Morvan
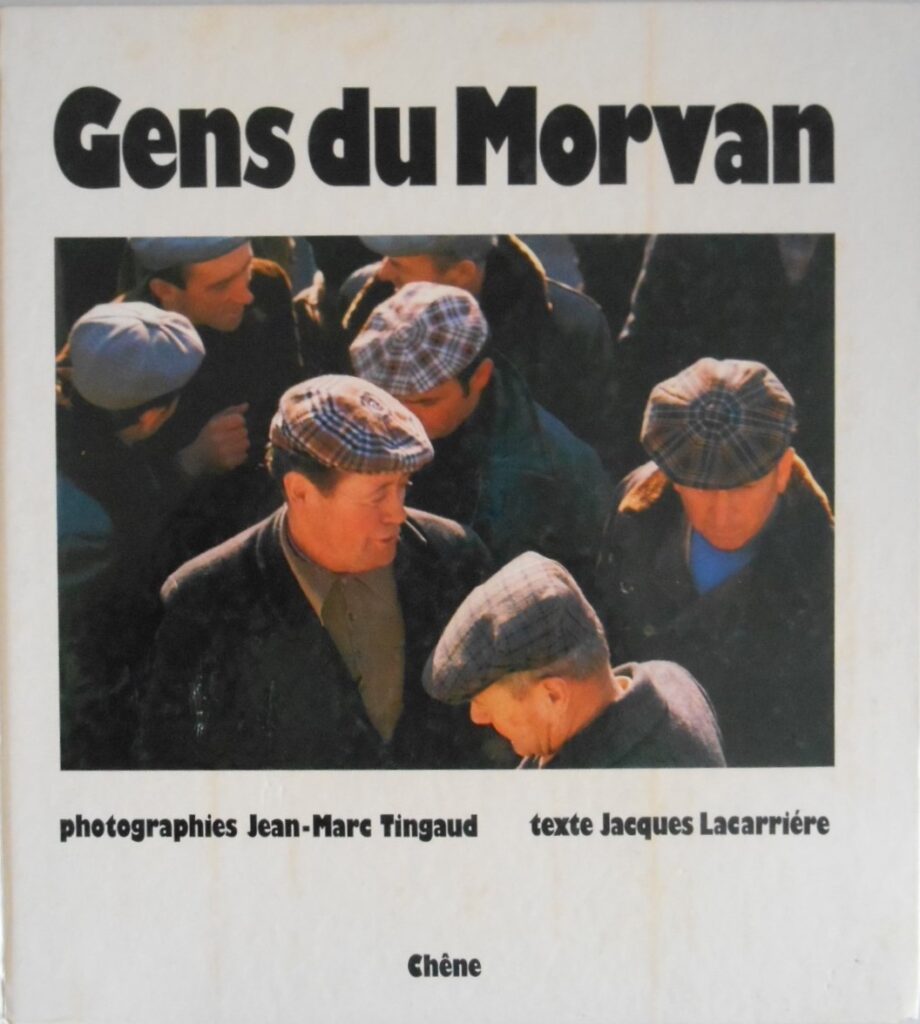
Texte de Jacques Lacarrière, photographies de Jean-Marc Tingaud
Le Chêne, 1978
Réimpression aux éditions de l’Armançon, 1991
Les Inspirés du bord des routes
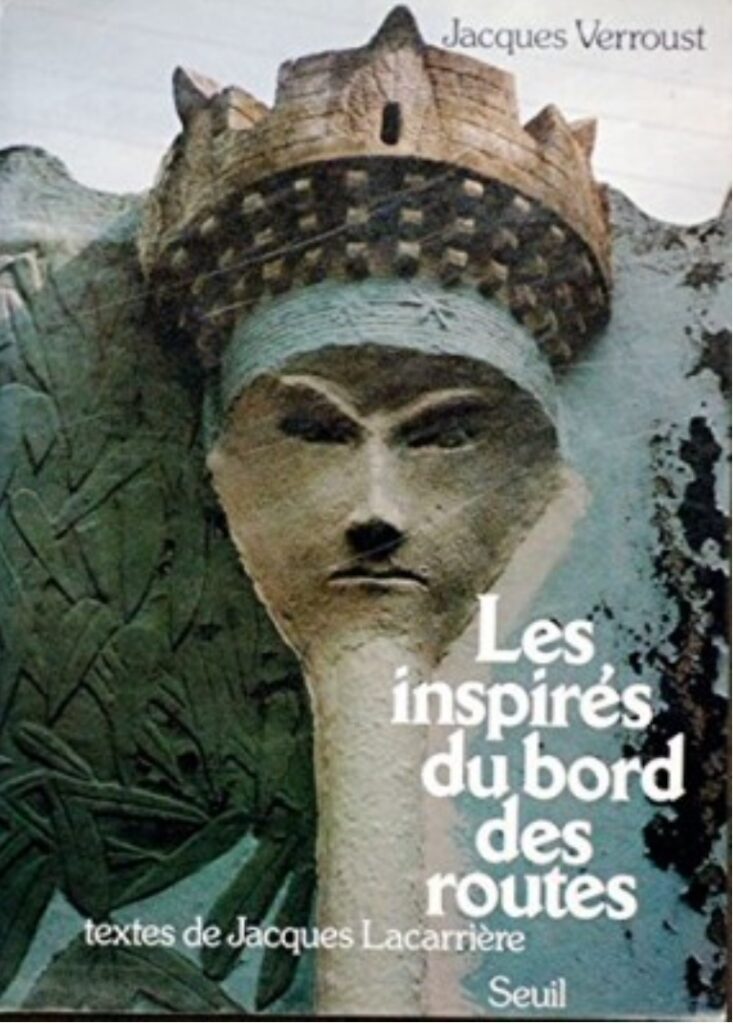
Textes de Jacques Lacarrière, photographies de Jacques Verroust
Paris, Le Seuil, 1978
» A mon sens, tout art est ificiel ou, si l’on veut artificiel . Hors le grand avantage de l’autre- l’art non ificiel que ces photos proposent – c’est qu’il envoie paître une fois pour toutes aux prairies du néant toutes ces notions de naïveté , de natur-alité, de brut-alité (pour l’art dit « brut » cher à Jean Dubuffet ) et de nous mettre une fois pour toutes en face de l’évidence :
il n’est d’art que fait de doigts, de mains , de muscles, de neurones et de cerveaux d’hommes. Il n’est d’art que de ruse, de parades, de supputations et de précautions contre les pièges du vide et de l’ennui, les sables mouvants du néant, l’insoutenable bleu du ciel , la blancheur suspecte de la toile, bref il n’est d’art que d’apposition en mettant quelque chose là où rien n’existait .
La Cendre et les Étoiles
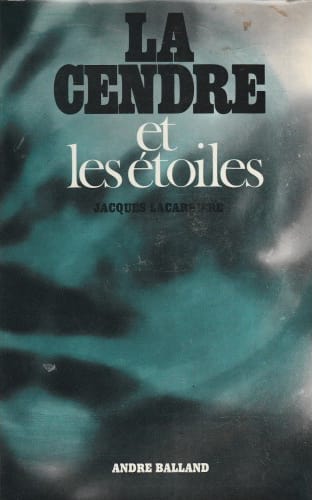
Première édition des Gnostiques
Balland, 1970
Promenades à Moscou et à Léningrad
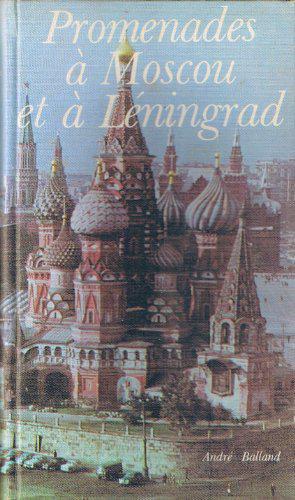
André Balland, Paris, 1969, collection Les promenades
